
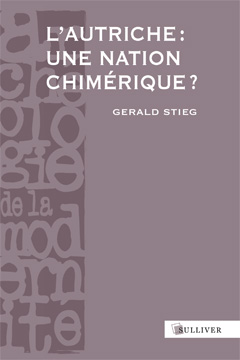
Pour Hitler, la disparition de l'Autriche représentait la priorité politique absolue. Mais il exprimait une opinion largement partagée par la population autrichienne. L'ironie de l'histoire a voulu que la conscience d'une véritable identité nationale autrichienne se soit développée pendant la réunion forcée avec la «mère patrie» allemande (1938-1945).
Cet essai, nourri par la vision personnelle de l’auteur, retrace les étapes historiques et politiques essentielles de l'État autrichien du XVIIIe siècle à nos jours. Il s’attache également à décrypter la multitude de discours politiques, théoriques et littéraires qui ont accompagné ou précédé la lente construction de l'identité autrichienne. Et nous montre comment l'austro-marxisme et le catholicisme politique, les auteurs majeurs du vingtième siècle (Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil, Josef Roth) et les émigrés (Stefan Zweig, Oskar Kokoschka, Elias Canetti) ont contribué, parfois par la contradiction, à affirmer la spécificité autrichienne face à la séduction ou à la menace exercées par l'idée de la Grande Allemagne.
Gerald Stieg, né en 1941 à Salzbourg, vit depuis 1969 en France. Il a étudié la théologie, la philosophie et la philologie à Innsbruck, Graz et Paris. En 1975, année de sa naturalisation, il est membre fondateur de la revue Austriaca qu’il a dirigée de 1982 à 2004. Depuis 1988, il est professeur de culture et littérature allemandes et autrichiennes à la Sorbonne Nouvelle. Il a été directeur de l’Institut d’Allemand d’Asnières, de l’équipe de recherche sur les sociétés et cultures germanophones et de l’Ecole doctorale «Espace européen contemporain.»
L'essai de Gerald Stieg se distingue par l'originalité et la diversité des documents analysés et surtout par ce don qui est le sien de pointer les paradoxes, de procéder à des rapprochements aussi ingénieux qu'éclairants et par l'aisance avec laquelle il navigue entre la haute culture et la culture populaire.
Dieter Hornig - Europe
Il est vrai que l'essentiel de l'expression de l'Autriche, donc sa «culture», passe par la langue allemande, qui n'est en rien le fait de la seule Allemagne, en dépit de ce qu'aurait voulu une part de l'opinion publique. C'est sur cette contradiction intérieure, sur les deux visées opposées de l'usage littéraire et politique de la langue allemande, que porte le livre de Gerald Stieg, par le biais des faits historiques, des personnalités et des œuvres qu'il examine.
Georges-Arthur Goldschmidt - La Quinzaine littéraire
Parmi les traits invariables de la question de l’identité autrichienne, il y a depuis le début du XIXe siècle la conviction largement partagée que la nation autrichienne n’était pas une réalité, mais une «idée», voire «une chimère», donc une construction mentale. Cette construction s’opposait aux nations réelles que tout le monde considérait comme des phénomènes naturels fondés essentiellement sur la langue. L’Allemagne est «partout où résonne la langue allemande», donc aussi en Autriche. En revanche, l’Autriche réclamait pour elle un statut ontologique supérieur comparable aux idées platoniciennes. C’est donc un vrai paradoxe que la nation virtuelle imaginée par les porteurs de l’idée autrichienne soit devenue une réalité historique et politique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les Autrichiens seraient donc arrivés tardivement au stade de «camaraderie profonde, horizontale» (Anderson) et non pas au surpassement de l’infantilisme national par l’idée d’une nation au-dessus des nations. Pour eux, plus jeune nation européenne malgré leur histoire «millénaire», cette «camaraderie profonde» a entraîné une rupture de la camaraderie historique avec les Allemands et une dévalorisation de l’unité linguistique. Sans la défaite de Hitler, il n’existerait pas (plus?) de nation autrichienne. Ses détracteurs ont-ils raison de la traiter d’«invention de 1942», donc comme une trahison de la nation allemande provoquée par Stalingrad, ou d'«invention communiste», voire de «fausse couche de l’histoire»? Tandis que les Allemands s’efforçaient à expier leur folie nationale, les Autrichiens qui y avaient participé de force ou de gré, se mettaient à construire une nation dont l’essence était de ne pas (plus) être allemande. Et pour y arriver, l’étranger, en la personne des Alliés victorieux du Troisième Reich, imposait à la République souveraine l’interdiction éternelle de l’Anschluss à l’Allemagne comme s’il avait un doute sur la fiabilité de cette nation nouveau-née qui réclamait pour elle une histoire millénaire.
Aujourd’hui elle existe. Du moins les sondages ne permettent plus aucun doute sur la «prise de conscience de la nation autrichienne» (Félix Kreissler). Les Autrichiens ont appris à être des Autrichiens. [...]
Les considérations qui vont suivre ne sont pas une description historique du processus de «prise de conscience» de la nation autrichienne après 1945. Elles sont essentiellement consacrées au socle historique, politique, culturel et symbolique d’une question qui semblait avoir trouvé en 1938 sa solution finale. Canetti dit que ce genre de questions dépasse l’horizon de l’historien «normal». Je conviens volontiers que cet essai est fortement teinté de subjectivité. Il m’a paru impossible de faire abstraction de mon vécu d’Autrichien né sujet du Troisième Reich et devenu citoyen français en 1975. L’histoire de la (re)naissance de l’identité autrichienne, je l’ai vécue d’abord inconsciemment, puis consciemment, enfin comme acteur à la marge du processus. Je me permettrai donc de mêler des souvenirs personnels aux documents multiples qui forment le soubassement de mes réflexions. Je présenterai ces documents sous la forme d’une sorte de disputatio où les advocati Austriae affronteront les advocati Germaniae. Mes propres sympathies dans ce combat idéologique ne font pas de doute, mais elles ne sont pas l’expression d’une foi absolue en une entité sacrée. Le débat contient trop de positions que je qualifierais de délirium pour ne pas introduire dès le départ une dose nécessaire d’ironie dans mon propos. Alors qu’on lui demandait en 1936 s’il croyait en l’existence d’une littérature autrichienne, Robert Musil, probablement son représentant le plus important au XXe siècle, avait répondu: «Oui, mais pas trop.»